 Un chauffeur d’Uber requalifié en salarié
Un chauffeur d’Uber requalifié en salarié
mercredi 11 mars 2020
Dans le langage courant, l’« ubérisation » désigne la précarisation caractéristique de l’emploi proposé par les plateformes numériques de mise en relation des travailleurs avec les usagers de certains services, notamment de VTC (véhicules de transport avec chauffeurs) et de livraison de repas. Par extension, l’« ubérisation » symbolise la précarisation de nombreuses formes d’emploi, notamment par la qualification abusive des travailleurs en « indépendants ». Toutes les entreprises qui contournent ainsi le droit du travail ne mettent pas en œuvre des technologies digitales ; mais ces dernières facilitent la dissimulation de la subordination des travailleurs et contribuent puissamment à l’amplification de la fraude.
Dans ce contexte, la conclusion du contentieux qui opposait à la société UBER un chauffeur de VTC réclamant la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail était particulièrement attendue. Depuis ce jeudi 4 mars c’est chose faite. Dans un arrêt rendu en formation plénière, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que la Cour d’Appel, qui avait constaté que UBER « avait adressé des directives (au chauffeur), en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction… avait légalement justifié sa décision » de requalifier en contrat de travail le contrat qui l’avait lié à cette société et que celle-ci avait rompu en désactivant son compte sur la plateforme (Cass. Soc. 4/3/2020, pourvoi n°19-13.316). De surcroît, en décidant de donner à son arrêt le maximum de publicité (publication d’un communiqué de presse et d’une note explicative ; publication de l’arrêt au bulletin civil des arrêts de la Cour et dans son bulletin d’information, au rapport annuel de la Cour et sur son site internet), la haute juridiction souligne la portée jurisprudentielle qu’elle entend conférer à sa décision.
Pour autant, la nouveauté de cette décision ne réside que dans les types d’acteurs concernés (plateformes numériques et chauffeurs de VTC). En soi, la solution que la Cour apporte à ce litige ne marque aucun revirement dans sa jurisprudence ; c’est une décision parfaitement classique. Mais, elle détonne par rapport aux tentatives des pouvoirs publics, exécutif et législatif, d’assigner des règles particulières aux relations entre les plateformes numériques et leurs travailleurs.
Un arrêt conforme à une jurisprudence classique pour une activité qui se veut hors norme
Chargée de contrôler la bonne application du Droit par les juridictions de première instance et d’appel afin de maintenir l’unité du Droit dans l’espace national et dans le temps, la Cour de Cassation commence par rappeler que la présomption d’indépendance qui résulte de l’inscription d’une personne physique au registre du commerce ou au répertoire des métiers n’est qu’une présomption simple, dont la preuve contraire est donc toujours recevable (art. L.8221-6 C. Trav.). Ajoutons que, depuis des lustres, la jurisprudence exclut que le statut d’un travailleur puisse dépendre de la volonté exprimée par les parties à un contrat (v. not. arrêt Bastille Taxi 19/12/2000, pourvoi n°98-40572). La Cour de Cassation pointe un à un les éléments factuels que la Cour d’Appel a vérifiés souverainement que, comme celle-ci, elle retient comme pertinents :
- « Le fait de pouvoir choisir ses jours et ses heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée dès lors que, lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV ».
- « Les tarifs sont contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix, puisque le contrat prévoit en son article 4.3 une possibilité d’ajustement par Uber du tarif notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire ″inefficace″… ».
- « S’agissant des conditions d’exercice de la prestation de transport, … Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des courses (en incitant les chauffeurs à se déconnecter lorsqu’ils ont refusé successivement trois courses, en se réservant le droit de restreindre l’accès du chauffeur à l’application et même de la désactiver ″à sa discrétion raisonnable″) et en les incitant à rester connectés pour espérer effectuer une course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur convient ou non… ».
- « Sur le pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses et les corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un itinéraire ″inefficace″, (la fixation par la société Uber dans chaque ville) d’un taux d’annulation de commandes pouvant entraîner la perte d’accès au compte y participe, tout comme la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de comportements problématiques par les utilisateurs… ».
Ainsi se trouvent réunis les critères de l’existence d’un contrat de travail, « l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Ces critères étaient déjà définis par une jurisprudence ancienne et constante, notamment dans un arrêt Société Générale du 13/11/1996 (pourvoi n°94-13.187), et déjà appliqués à un litige entre une plateforme numérique de livraison de repas, Take Eat Easy, et l’un de ses travailleurs (Cass. Soc. 28/11/2018, pourvoi n°17-20.079). La décision commentée ici est d’autant moins de nature à surprendre que les juridictions d’autre pays (notamment l’État américain de Californie et le Royaume-Uni), appliquant des règles équivalentes, ont déduit des mêmes faits la même conclusion.
Un arrêt aux allures de pavé dans la mare
La décision du 4 mars confirme que, pour la Cour de Cassation, il n’existe pas de statut intermédiaire entre indépendance et salariat. Du moins, est-ce au législateur d’en décider autrement. Or, jusque récemment, de tels statuts ne régissaient que quelques autres professions, notamment les travailleurs à domicile et les gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Par deux fois ces dernières années (lois n°2016-1088 du 8/8/2016 et n°2019-1428 du 24/12/2019), le législateur s’est efforcé, selon ses propres termes, de fixer les modalités de mise en œuvre de la « responsabilité sociale » qu’il impute à la plateforme numérique envers « les travailleurs indépendants » qui y recourent lorsqu’elle « détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix » (art. L.7342-1 du code du travail).
Ainsi, la plateforme doit-elle prendre en charge la cotisation à l’assurance couvrant les risques d’accident du travail, pour autant toutefois, que le travailleur prenne l’initiative de souscrire l’assurance volontaire prévue par le code de la sécurité sociale, à moins que la plateforme souscrive un contrat collectif et que le travailleur y adhère (art. L.7342-2 C. Trav.). Le droit d’accès à la formation professionnelle est aussi reconnu au travailleur, la plateforme supportant la charge de la contribution. Si le travailleur bénéficie à sa demande d’une action de formation, la plateforme supporte les frais d’accompagnement et l’indemnité due au travailleur. Au-delà d’un chiffre d’affaires réalisé par le travailleur, propre à chaque secteur d’activité, la plateforme doit abonder son compte personnel de formation (art. L.7342-3 et D.7342-1 à D.7342-5 C. Trav.). Le droit de grève est reconnu aux travailleurs dès lors que « les mouvements de refus concerté de fournir leurs services… ne peuvent ni engager leur responsabilité contractuelle ni constituer un motif de rupture… » ni justifier une sanction quelconque (art. L.7342-5 C. Trav.). De même leur est reconnu le droit d’adhérer à des syndicats ou d’en constituer (art. L.7342-6 C. Trav.). Enfin, leur est reconnu le droit d’accès « à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme » (art. L.7342-7 C. Trav.).
À ces règles générales, la loi du 24/12/2019 a ajouté des dispositions propres aux relations entre plateformes et travailleurs exerçant les activités de conduite de VTC ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues. Tenant compte de l’initiative prise par certaines plateformes de réglementer par des « chartes » unilatérales les relations entre elles-mêmes et leurs chauffeurs, le législateur s’est efforcé de conférer à ces chartes une portée qui prémunirait les plateformes du risque de requalification des contrats.
En substance, la loi reconnaît les chartes dans lesquelles les plateformes « précisent notamment les conditions d’exercice de l’activité professionnelle…, modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation, modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels, mesures visant à améliorer les conditions de travail, à prévenir les risques professionnels, les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs, modalités selon lesquelles les travailleurs sont informées de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle, la qualité de service attendue, les modalités de contrôle de l’activité par la plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture… (d’éventuelles) garanties de protection sociale complémentaire… » (art. L.7342-9, 1° à 8°, C. Trav.). Bref, il est reconnu aux plateformes la faculté de réglementer les conditions d’emploi des chauffeurs, bien que ce soient en principe des travailleurs indépendants.
Le texte adopté par le Parlement disposait que, « lorsqu’elle est homologuée par l’autorité administrative, l’établissement de la charte [et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° et 8° du présent article] ne peut caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs ». Cependant, le Conseil Constitutionnel a censuré comme non conforme à la constitution la partie de ce texte mise ici entre parenthèses. Rappelant que l’article 34 réserve au législateur le pouvoir de déterminer, parmi les « principes fondamentaux du droit du travail », le « champ d’application (de ce droit) et, en particulier, les caractéristiques du contrat de travail », Le Haut Conseil a condamné la faculté donnée aux opérateurs des plateformes « de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique et, par voie de conséquence, l’existence d’un contrat de travail » (C. Constit. 20/12/2019, n°2019-794 DC, point n°28). En conséquence de la suppression des mots cités ci-dessus entre parenthèses, le texte promulgué (art. L.7342-9 C. Trav., not. dernier alinéa) signifie seulement que ni l’existence d’une charte, ni son contenu ne suffisent à établir un lien de subordination juridique entre la plateforme et ses chauffeurs. Conséquence parfaitement conforme à la jurisprudence, selon laquelle la subordination doit être prouvée en fait par la réunion d’indices convergents relatifs au pouvoir de diriger le travail, de le contrôler et de le sanctionner.
Force est donc de constater que la tentative de soustraire à l’application judiciaire des critères de la subordination juridique les relations entre les plateformes de VTC et de livraison de marchandises et leurs chauffeurs et cyclistes a échoué. Pour autant que, dans le cas de ces derniers, un statut intermédiaire entre celui de travailleur indépendant et le salariat soit pertinent, le législateur est renvoyé à l’exercice du pouvoir, qui lui appartient en propre, d’établir un tel statut. Mais celui-ci pourrait-il s’appliquer à des relations de travail caractérisées par une subordination juridique dans les trois domaines cruciaux de la direction, du contrôle et de la sanction ? Qu’il soit permis d’en douter. Comment, en effet, pourrait-on justifier que la même subordination affranchisse l’employeur d’un chauffeur de VTC ou d’un livreur cycliste de l’application du code – et, plus généralement, au droit – du travail selon qu’il met en œuvre ou non une plateforme numérique ?
{}
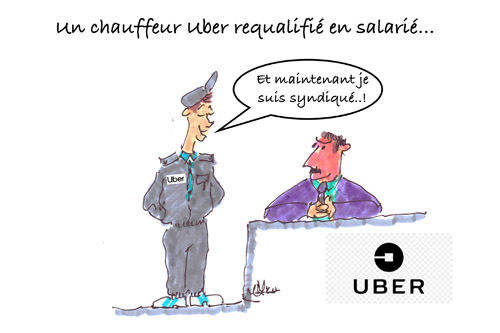
{}
Dans la même rubrique
- Plus d’un travailleur sur trois a un motif d’insatisfaction par rapport à son emploi
- Plus de dérogation possible à la durée maximale de la période d’essai
- La moitié des abandons de poste sont réalisés avec l’accord de l’employeur
- Le recours aux contrats courts en nette augmentation
- Baisse du nombre de salariés détachés depuis le covid
- Deliveroo, condamné pour travail dissimulé
- Espagne, les livreurs à vélo deviennent des salariés
- Regard sur les travailleurs détachés en France en 2019
- Quelles réalités des contrats courts ?
- L’augmentation de l’emploi dans la fonction publique est imputable aux contractuels
Mots clés associés à l'article